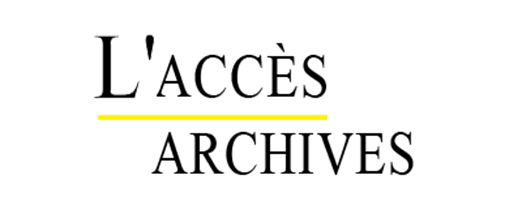Cloud computing: Beaucoup d’appelés, très peu d’élus
De plus en plus d’entreprises et administrations publiques ne jurent que par le «Cloud local» au prétexte de la réglementation. Pourtant, seules les données dites «sensibles» doivent faire l’objet d’un hébergement sur le territoire national. «Rares sont les administrations qui font le travail préalable de classifier leurs données», soutient Julien Poirot, consultant Google Cloud et directeur chez Maroc Cloud...