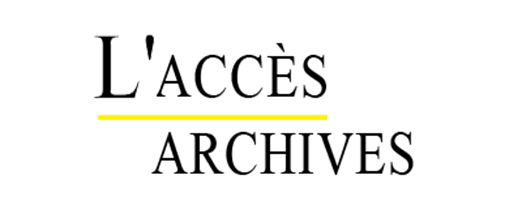Remettre à plat la politique anti-drogue
Pour endiguer la propagation de la coronavirus dans les lieux de détention, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de libérer des dizaines de milliers de détenus, en particulier celles et ceux qui, condamnés pour des actes exempts de violence, ne représentaient pas de danger pour la collectivité...