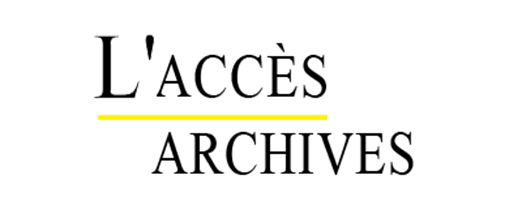Covid-19: Quels scénarios pour une sortie de crise(1) (1re partie
Il est difficile d’explorer des pistes qui indiqueraient un raccourci pour une sortie de crise, sans se retrouver dans des sentiers battus. Il peut aussi être intéressant d’indiquer les chemins périlleux à ne pas emprunter, intéressant également de poser de bonnes questions plutôt que d’apporter de mauvaises réponses...