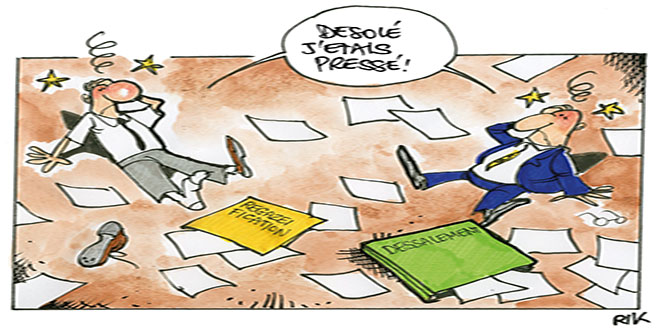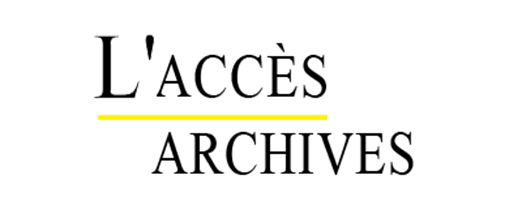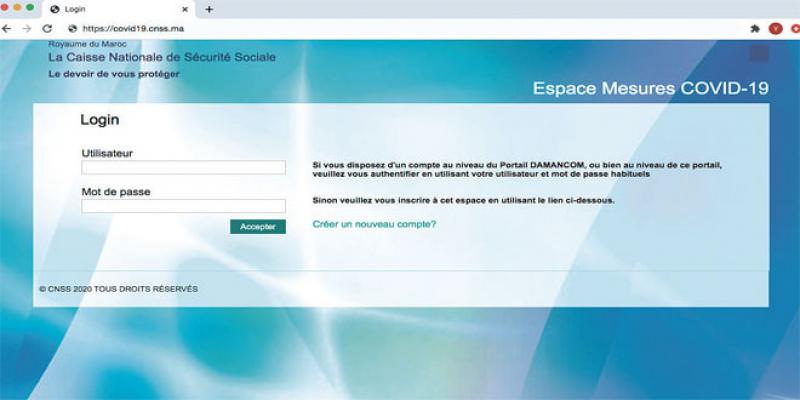Conjoncture économique: Quelques signes et beaucoup d’incertitudes
Le Conseil de Bank Al-Maghrib, qui a tenu hier mardi 22 septembre sa troisième réunion trimestrielle, a maintenu le taux directeur inchangé à 1,5%. En revanche, il a revu à la baisse les prévisions de croissance. Le PIB devrait ainsi se contracter de 6,3% en raison notamment du redémarrage plus long que prévu de l’activité économique. S’y ajoutent, les restrictions locales ou sectorielles suite à la recrudescence des contaminations.