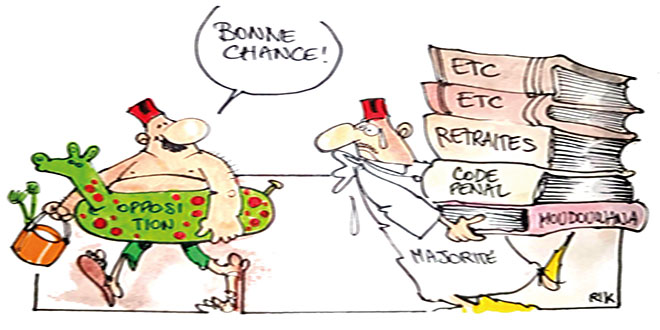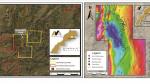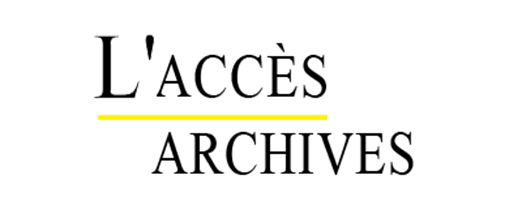Au-delà du Covid, préserver l’emploi et l’inclusion sociale
Quelle stratégie pour redresser la barre au-delà de la pandémie? Surtout que la récession mondiale touche en premier lieu les personnes les plus vulnérables. Le HCP, le Système des Nations unies au Maroc et la Banque mondiale ont développé une approche stratégique commune. L’objectif est d’analyser les retombées et de formuler des recommandations...