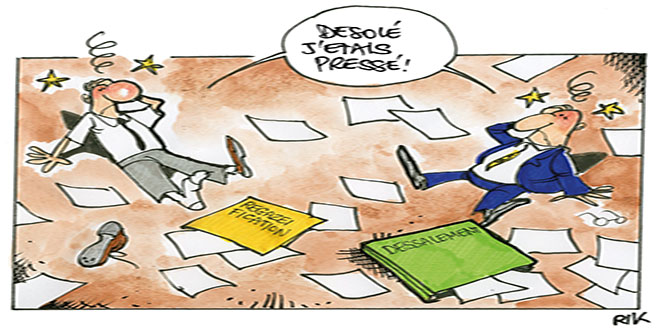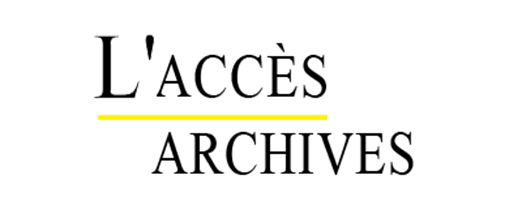Confinement: Hausse des scènes de ménages
L’accompagnement scolaire des enfants, les soucis financiers et les tâches ménagères sont les causes des disputes conjugales pendant le confinement. La gestion du budget en particulier est source de tension pour plus d’un Marocain sur cinq. Les parts les plus élevées sont enregistrées parmi les jeunes de moins de 24 ans (28%), les chômeurs (26%), les couples ayant des enfants (26%) et les ruraux (25,4%). Plus de 8,4% des Marocains ont également signalé avoir eu des disputes conjugales au sujet du partage des tâches ménagères. Il se trouve aussi que la charge de travail s’est amplifiée pour les femmes.