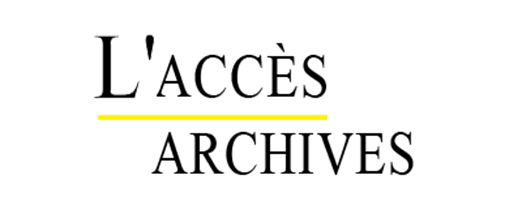Agriculture biologique: Le pari de la mise à niveau de la filière
Contraintes à la pelle. La filière de l’agriculture biologique, ce fleuron du secteur primaire, en dénombre à tous les étages. Et pour les lever, l’interprofession fait appel à plus d’aide de l’Etat. Ceci, faute de moyens financiers propres qu’elle n’arrive pas à drainer par les contributions des membres. Ceux-ci sont au nombre de 66 adhérents pour une filière qui compte 300 opérateurs...