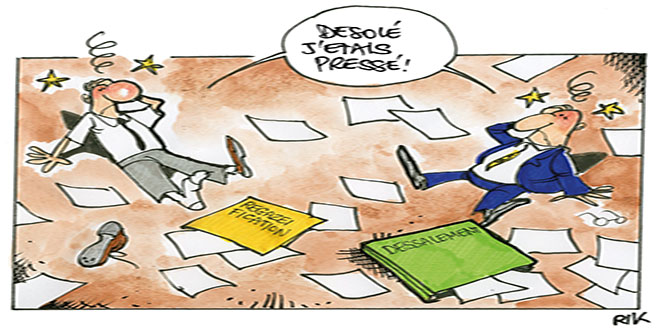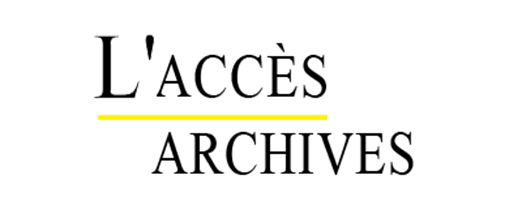Croissance en Afrique: Dur retour à la réalité
L’intérêt pour l’Afrique faiblit mais ne s’estompe pas pour autant. Dès la fin des années 2000, avec la fin de plusieurs conflits armés, les pays du continent ont vu leur croissance monter en flèche grâce à une importante demande en infrastructures. Des taux de croissance à deux chiffres insolents à l'époque, mais aussi très éphémères, la réalité ayant repris le dessus très rapidement...